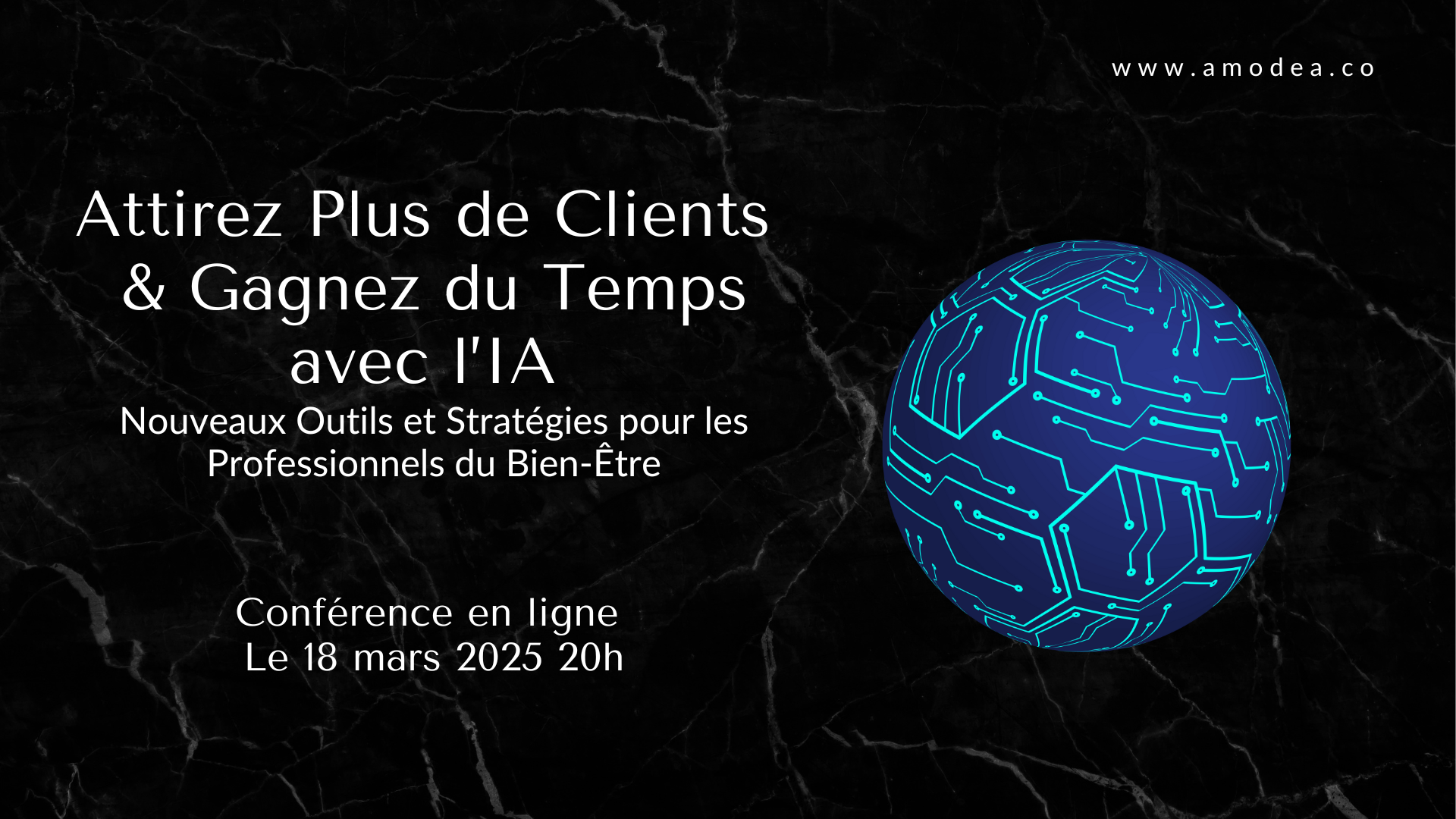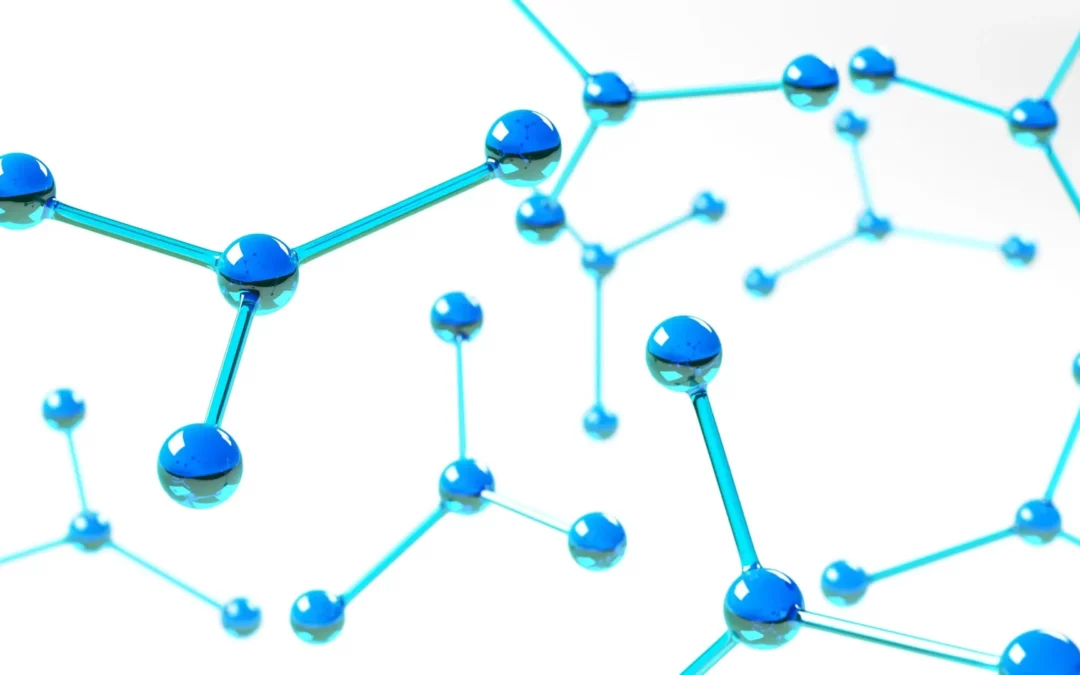
Les PFAS : Que sont-ils et devons-nous nous en inquiéter ?
Dans notre quête d’un mode de vie plus sain et respectueux de l’environnement, nous faisons attention à la qualité des aliments que nous consommons, aux produits d’entretien que nous utilisons et aux objets du quotidien qui nous entourent. Nous choisissons des contenants en verre, évitons de réchauffer des aliments dans du plastique et remplaçons nos poêles antiadhésives vieillissantes par des alternatives plus sûres comme l’inox ou la fonte. Mais savons-nous vraiment pourquoi ces choix sont cruciaux pour notre santé ?
Récemment, en écoutant un podcast sur les substances toxiques, j’ai entendu parler des PFAS. Ce mot m’a intriguée, et après quelques recherches, j’ai découvert une réalité alarmante sur ces substances chimiques omniprésentes et leurs effets sur notre santé.
Que sont les PFAS ?
Les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) sont des composés chimiques synthétiques développés par DuPont dans les années 1930. Initialement conçus pour résister à l’eau et aux graisses, ces composés ont été largement adoptés dans les industries textile, alimentaire et cosmétique. On les retrouve notamment dans les revêtement antiadhésifs des ustensiles de cuisine, les emballages alimentaires, les vêtements imperméables et même certains produits de soins personnels.
Le problème ? Ces substances, qualifiées de « polluants éternels », ne se dégradent pas facilement et s’accumulent dans l’environnement, les organismes vivants et notre propre corps.
Où trouve-t-on les PFAS ?
Les PFAS sont invisibles à l’œil nu et rarement mentionnés sur les étiquettes des produits. Pourtant, ils sont présents dans de nombreux objets du quotidien :
-
Ustensiles de cuisine antiadhésifs (poêles en Teflon, moules à gâteaux)
-
Vêtements et textiles d’extérieur (vestes imperméables, tenues de sport, tapis)
-
Emballages alimentaires (sachets de popcorn micro-ondable, boîtes à pizza, barquettes en plastique)
-
Cosmiques et produits d’hygiène (mascaras waterproof, fonds de teint longue tenue, fils dentaires traités)
-
Mobiliers et textiles traités contre les taches (canapés, moquettes, rideaux)
Autrement dit, si un produit est résistant à l’eau, aux graisses ou aux taches, il contient probablement des PFAS.
Les PFAS sont-ils dangereux ?
Bien que les effets à long terme des PFAS sur l’homme ne soient pas encore entièrement connus, des études ont démontré des conséquences alarmantes sur la santé animale et humaine, notamment :
-
Augmentation du cholestérol
-
Perturbation des enzymes hépatiques
-
Risque accru de pré-éclampsie chez les femmes enceintes
-
Diminution du poids des nourrissons à la naissance
-
Augmentation des risques de cancer du rein et des testicules
-
Prédisposition au diabète de type 2
Face à ces données, l’Agence de Protection de l’Environnement (EPA) aux États-Unis a classé certains PFAS comme substances dangereuses en 2022. Toutefois, malgré l’interdiction progressive de certains d’entre eux (comme le PFOA et le PFOS), ces substances restent largement utilisées et persistent dans notre environnement.
Comment réduire son exposition aux PFAS ?
Bien que nous ne puissions pas éviter complètement les PFAS, il est possible de limiter notre exposition au quotidien :
-
Remplacer les ustensiles de cuisine antiadhésifs par de l’inox, de la fonte ou de la céramique.
-
Choisir des vêtements et textiles naturels, comme le coton bio, le lin et le chanvre.
-
Privilégier les cosmiques sans PFAS, en évitant les mascaras waterproof, les fonds de teint longue tenue et les fils dentaires enduits.
-
Utiliser un filtre à eau, idéalement par osmose inverse ou à charbon actif, pour éliminer les traces de PFAS dans l’eau du robinet.
-
Réduire l’usage d’emballages alimentaires traités, en optant pour des contenants en verre ou en inox.
-
Se renseigner sur les marques engagées, qui adoptent des alternatives plus sûres aux PFAS, comme Patagonia, Cotopaxi et certaines entreprises alimentaires.
Un enjeu de santé publique et environnementale
Les PFAS ne sont pas seulement un problème individuel, mais une question de santé publique qui nécessite une réglementation plus stricte et une prise de conscience collective. Certains États, comme la Californie et New York, commencent à interdire leur usage dans certains produits, et des efforts scientifiques sont en cours pour les éliminer de notre environnement.
En attendant, nous avons tous un rôle à jouer en tant que consommateurs : faire des choix plus éclairés, soutenir les entreprises responsables et interpeller nos gouvernements pour une réglementation plus stricte. Car si les PFAS sont invisibles, leurs effets, eux, sont bien réels.